Nous venons de vivre en l’espace de six mois une crise sanitaire mondiale, d’une ampleur et d’une vitesse de propagation inédites. Elle est loin d’être terminée. Nous venons de la vivre dans une espèce d’étonnement, voire de sidération collective, et sans qu’aucune instance mondiale n’ait pu réellement en coordonner la gestion. Qu’est-ce que ce phénomène dit de l’état du monde ?
Cette crise révèle effectivement tout un ensemble de mutations et de transformations qu’on n’a pas voulu voir. L’essentiel de ces mutations ramène à la notion de « sécurité globale ». Si nous nous retournons sur les décennies et même les siècles qui précèdent, nous percevons que la sécurité a toujours été pensée et construite en termes nationaux. Or, avec cette crise sanitaire nous découvrons un scénario totalement différent : la menace n’est pas portée par un ennemi – même si certains veulent le reconstruire et l’imaginer –, elle ne répond pas aux plans d’un stratège, elle ne vise pas un territoire, elle ne transgresse pas des frontières ; mais elle vient cibler l’humanité dans son ensemble, à partir, non pas d’intentions malignes, mais de ce que j’appellerais « la simple mécanique des corps ». Et tout ceci change complétement l’idée-même de politique, que des personnages aussi controversés que Carl Schmitt ont pu envisager comme étant la cristallisation de l’opposition ami-ennemi.
La vielle idée grecque de polis prend alors tout son sens : la solidarité humaine est collectivement menacée. Cependant, au lieu de prendre la mesure de cette insécurité globale, au lieu d’imaginer les plans de construction d’une sécurité globale, on essaye de nationaliser les menaces qui pèsent sur nous aujourd’hui : on tend à considérer le virus comme un ennemi au lieu de l’appréhender comme un phénomène biophysique. On va le rattacher à une volonté






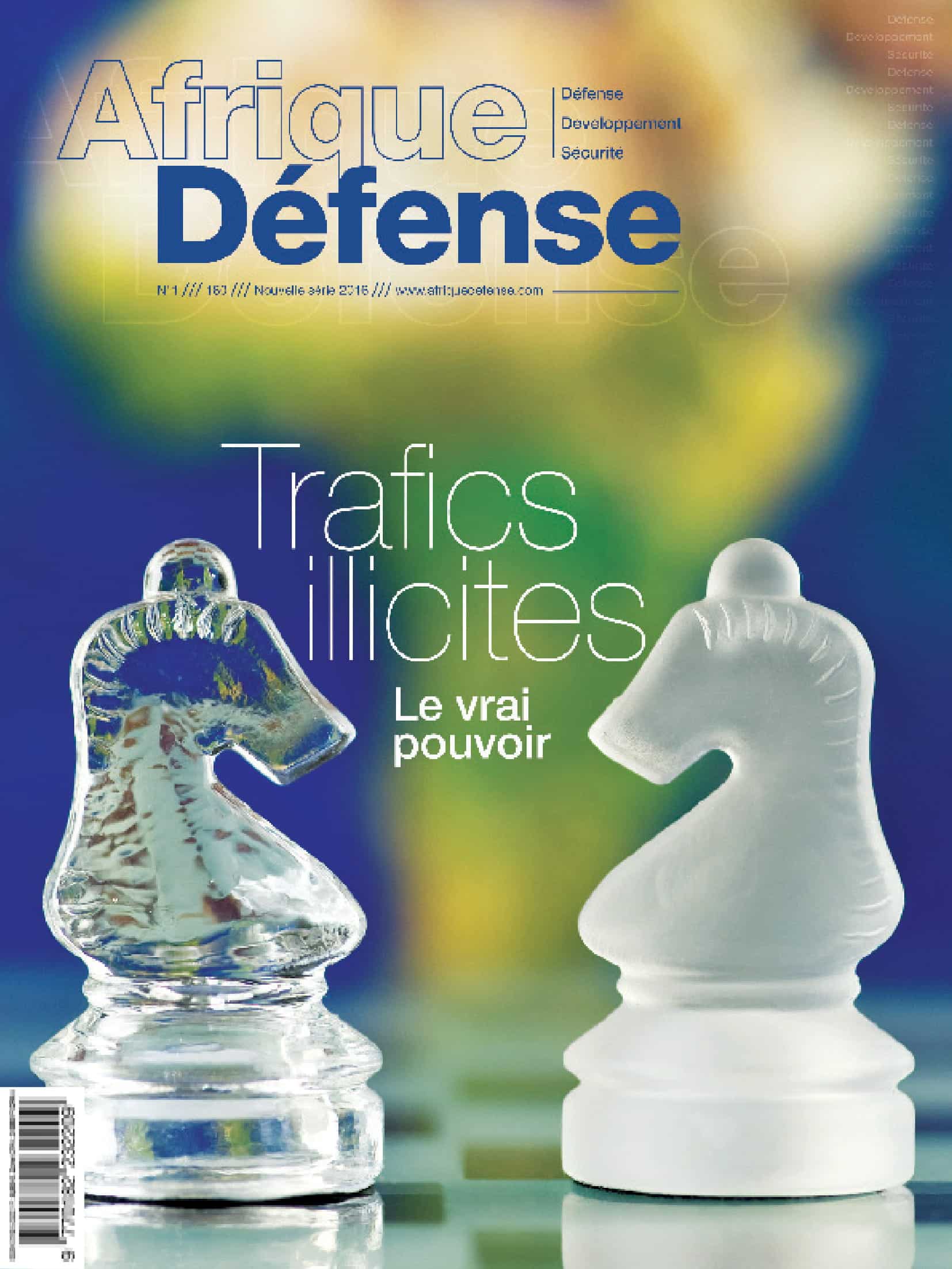




Commentaires