La crise sanitaire du coronavirus et le confinement qui en a résulté nous ont révélé le danger qu’il peut y avoir à étendre nos activités humaines aux dépens des forêts et à réduire les espaces naturels. La rencontre de la chauve-souris et du pangolin, qui serait à l’origine de l’épidémie actuelle, est sans doute une conséquence de la réduction des espaces naturels. L’habitat des espèces sauvages se trouve réduit et l’homme s’en rapproche toujours davantage. Cette crise nous rappelle qu’il faut cesser les déforestations et donc renoncer aux formes d’agriculture « intensives », qui ont toujours besoin de plus grandes extensions aux dépens des dernières forêts denses de l’Amazonie, du Congo, de Chine et d’Asie du Sud-Est.
Le manque de masques, de médicaments, de respirateurs dans les premiers moments de l’épidémie a souligné aussi l’importance de pouvoir s’assurer localement de la fabrication des produits de première nécessité sans avoir à dépendre de l’extérieur. Nous aurions pu connaître des tensions bien plus terribles dans le domaine de l’alimentation ; mais, fort heureusement, nous avons eu la chance que cette crise soit intervenue à un moment où les stocks mondiaux de céréales étaient élevés. À l’inverse de ce qui s’était produit en 2008, il n’y a pas eu de perspective de pénurie à l’échelle mondiale et donc pas de spéculation sur les marchés à terme.
Tableau de l’insécurité alimentaire et de ses causes
Mais le confinement dans un très grand nombre de pays a occasionné un tel chômage et de telles difficultés logistiques que le nombre de personnes qui durent souffrir de la faim et de la malnutrition s’est considérablement accru, par manque de pouvoir d’achat. Alors même que des produits comestibles continuaient d’être vendus à des fabriques d’aliments pour bétail et des entreprises d’agrocarburants, bien plus solvables que les gens mal nourris[1]. La sécurité alimentaire ne pourra donc être assurée au plus grand nombre d’humains que si l’on parvient à réduire les écarts de revenus à l’échelle mondiale et à relocaliser les productions vivrières de première nécessité à proximité des lieux de consommation sans avoir à dépendre d’importations en provenance de pays lointains. Ce qui n’exclut pas la constitution de stocks de sécurité pour se prémunir contre toute spéculation.
La sécurité alimentaire ne pourra donc être assurée que si l’on parvient à réduire les écarts de revenus à l’échelle mondiale et à relocaliser les productions vivrières à proximité des lieux de consommation.

Les populations les plus pauvres de la planète qui ne parviennent toujours pas à acheter ou produire par elles-mêmes suffisamment de nourriture sont pour les deux tiers des paysans du Sud qui, travaillant encore à la main, ne parviennent pas à résister à la concurrence des grandes exploitations agricoles moto-mécanisées du Nord, de l’Argentine ou du Brésil, dont la productivité du travail est plus de deux cents fois supérieure à la leur. Le dernier tiers est constitué de familles qui ont quitté prématurément la campagne, faute d’y être restées compétitives, et qui ont donc rejoint les bidonvilles des grandes cités sans pouvoir trouver dans celles-ci les emplois espérés.
La pauvreté des campagnes alimente un exode rural de plus en plus massif, alors même que les industries les plus modernes ne procurent que de trop rares emplois. Sauf exception, les phénomènes de délinquance et d’insécurité qui résultent de la paupérisation et du chômage dans les villes n’incitent guère les entrepreneurs à y investir des capitaux et y créer des emplois. Nombreux sont alors les paysans qui optent pour migrer vers les dernières forêts primaires du monde et y défricher gratuitement de nouveaux terrains, au risque de mettre en péril des pans entiers de la biodiversité mondiale. Quant aux plus « fortunés » qui parviennent à payer des « passeurs » et tentent tant bien que mal de migrer clandestinement vers le Nord, ils risquent d’être brutalement refoulés et d’être à l’origine de fortes tensions internationales, car la circulation des personnes sur le marché mondial n’est pas aussi « libre » que celle des marchandises ou des capitaux.
La question alimentaire ne sera donc finalement résolue que si les paysanneries du Sud parviennent à sortir de leur pauvreté en augmentant leur productivité et leurs revenus.
La question alimentaire ne sera donc finalement résolue que si les paysanneries du Sud parviennent à sortir de leur pauvreté en augmentant leur productivité et leurs revenus, de façon à pouvoir produire ou acquérir suffisamment de nourriture, acheter les autres biens de consommation de première nécessité et acquérir les équipements les plus favorables à la mise en œuvre de systèmes de culture et d’élevage durables dans leurs unités de production. Les nations du Sud les plus déficitaires vont devoir retrouver au plus vite leur souveraineté alimentaire sans avoir recours abondamment à des intrants importés (semences hybrides, engrais de synthèse, produits phytosanitaires, etc.). Les pays excédentaires seraient bien inspirés, quant à eux, de moins exporter de denrées bas de gamme (céréales à peine panifiables, poulets de quarante jours, poudre de lait, etc.) vers les pays du Sud et de produire bien mieux, aux moindres coûts sanitaires et environnementaux.
Il existe des solutions techniques durables adaptées au Sud
Fort heureusement, d’un point de vue strictement technique, il existe d’ores et déjà des systèmes de production agricole capables d’accroître les productions à l’hectare, tant dans les pays du Sud que ceux du Nord, sans coût majeur en énergie fossile ni recours exagéré aux engrais de synthèse et produits phytosanitaires.
Il existe des systèmes de production agricole capables d’accroître les productions à l’hectare, sans coût majeur en énergie fossile ni recours exagéré aux engrais de synthèse et produits phytosanitaires.
Ces systèmes de production qui relèvent de l’agroécologie reposent sur la gestion en circuit court des cycles du carbone, de l’azote et des éléments minéraux : couverture maximale des sols par la biomasse végétale pour les besoins de la photosynthèse, association de l’élevage à l’agriculture, utilisation des résidus de culture pour l’affouragement des animaux, recours aux déjections animales pour la fabrication du fumier et des composts destinés à la fertilisation des sols, intégration de légumineuses dans les rotations de façon à utiliser l’azote de l’air pour la synthèse des protéines et la fertilisation des sols, remontée biologique des minéraux issus de la désagrégation des roches mères vers les couches arables, implantation ou maintien d’arbres d’ombrage ou de haies vives pour protéger les cultures des grands vents et héberger de nombreux insectes pollinisateurs, utilisation de bois raméaux fragmentés pour l’implantation de mycorhizes, régulation des cycles de reproduction des insectes ravageurs, maintien d’une grande biodiversité domestique et spontanée, etc.

Ils ne doivent surtout pas être qualifiés d’« extensifs » dans la mesure où ils font souvent un usage intensif des ressources naturelles renouvelables (l’énergie lumineuse, le carbone et l’azote de l’air, les eaux pluviales, etc.) et n’excluent pas l’obtention de rendements élevés à l’hectare. Mais ils font par contre un usage très limité des ressources non renouvelables (énergie fossile, eaux souterraines, mines de phosphate, etc.) et des intrants chimiques (engrais de synthèse, produits phytosanitaires, antibiotiques, etc.).
Ces systèmes exigent par ailleurs un travail plus intense et plus soigné que ceux inspirés de l’actuelle production agroindustrielle et peuvent donc être à l’origine de la création de nombreux emplois, pour peu que les aides accordées aux agriculteurs soient accordées préférentiellement aux paysans qui s’engagent à les mettre en œuvre, plutôt que de favoriser l’agrandissement inconsidéré d’exploitations surdimensionnées. Ces systèmes intensifs en travail sont particulièrement intéressants lorsque prévalent des situations de chômage chronique, avec un coût d’opportunité de la force de travail proche de zéro pour l’ensemble de la collectivité[2], quitte à envisager parfois la transformation des produits et sous-produits au sein même des exploitations ou au plus près des fermes, avec une attention particulière aux moyens d’éviter les pertes post-récolte ou post abattage.
Et en France ?
Dans des pays comme la France, le but n’est pas de produire davantage de ce dont nous sommes devenus excédentaires, mais de produire mieux, à de moindres coûts sanitaires et environnementaux. Il nous faut réduire nos exportations à vil prix de produits bas de gamme vers les pays du Sud : nos blés qui ruinent les producteurs de mil et de sorgho, notre poudre de lait qui met à mal les élevages laitiers du Sénégal ou d’ailleurs, les poulets bas de gamme qui concurrencent leurs basses-cours, etc. Certes, la pratique en France d’une agriculture diversifiée et résiliente inspirée de l’agroécologie se traduirait dans un premier temps par une baisse des rendements car nos écosystèmes ont été déjà fortement détériorés à cause des pesticides et des engrais de synthèse. L’humus a été détruit ; les coccinelles et les abeilles ne jouent plus leur rôle de lutte contre les pucerons pour les premières et de pollinisation pour les secondes. Il nous faut donc pouvoir en premier lieu rétablir la fertilité de nos agroécosystèmes. Mais à terme, la valeur ajoutée à l’hectare va pouvoir progresser avec de surcroît une diminution des dégâts sanitaires et environnementaux hérités de notre agriculture industrielle.
Dans des pays comme la France, le but n’est pas de produire davantage de ce dont nous sommes devenus excédentaires, mais de produire mieux.

Marc Dufumier
[1] On considère que pour nourrir correctement l’ensemble de l’humanité, il faudrait une production annuelle d’environ 200 kilogrammes de céréales par habitant ou leur équivalent en racines, tubercules, et autres plantes amylacées. Or la production mondiale est d’ores et déjà de 330 kilogrammes.
[2] L’agriculture est l’un des secteurs d’activités où les prix du marché intérieur reflètent le plus mal les coûts d’opportunités des ressources ne pouvant pas faire l’objet de transactions internationales (main-d’œuvre, terrains, eaux souterraines, etc.).






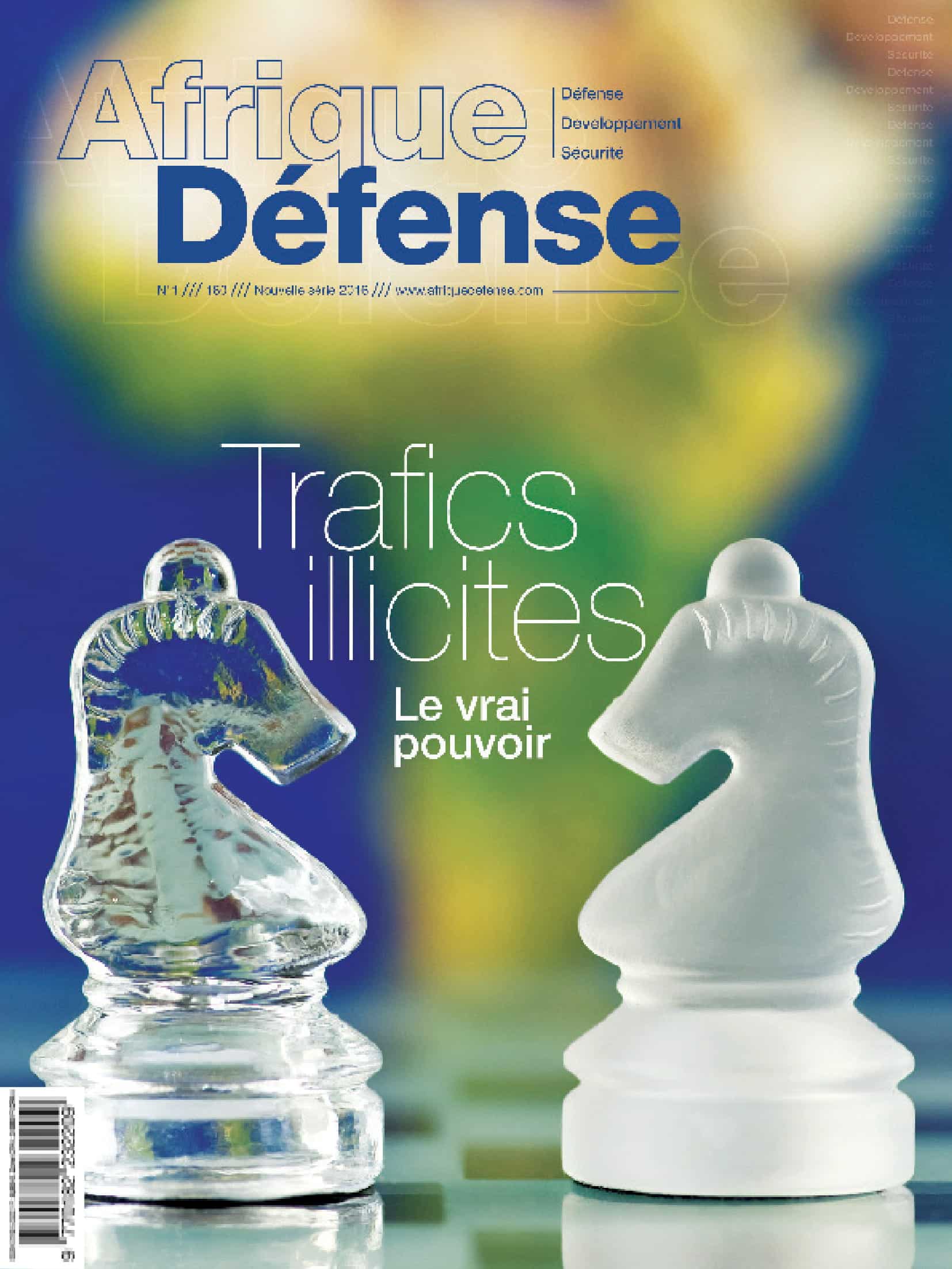




Commentaires