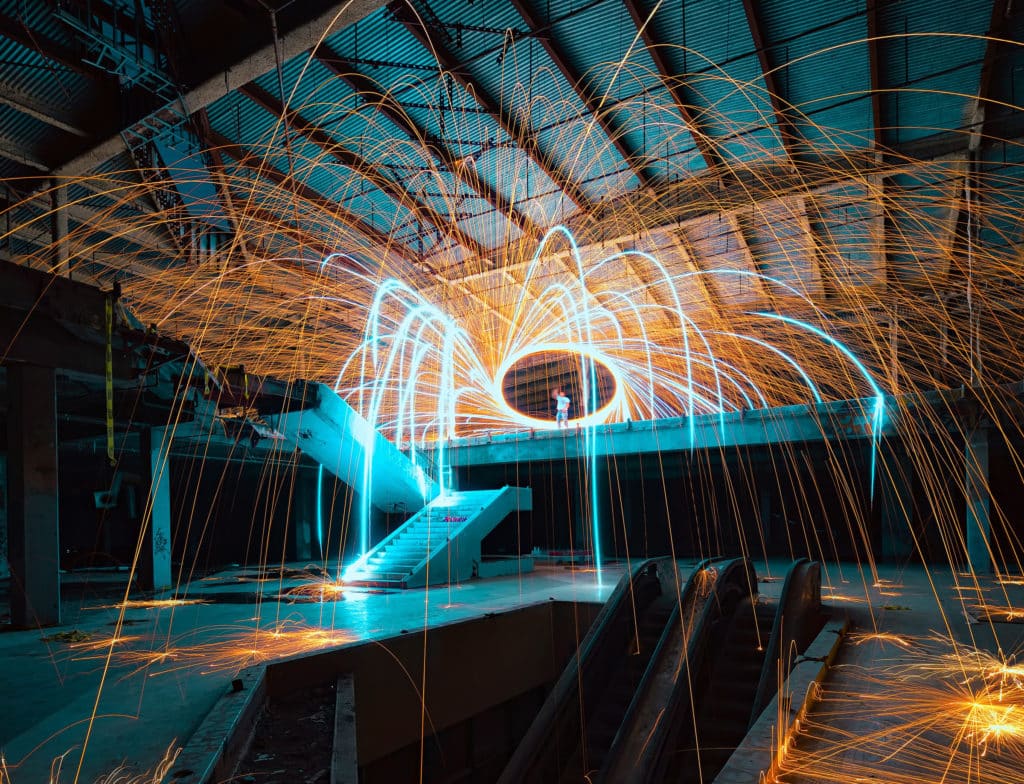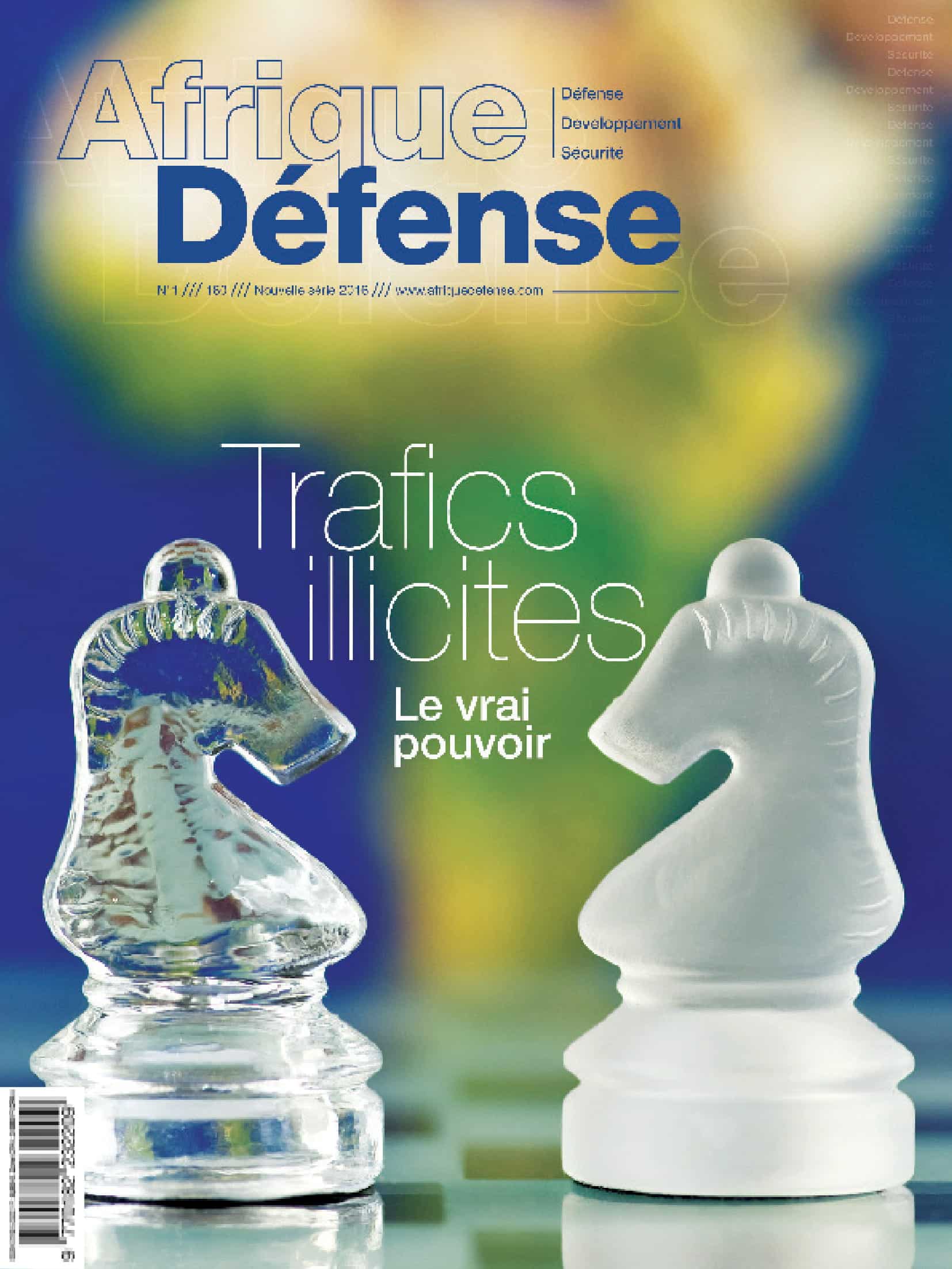La santé est un bien précieux, un bien supérieur, préoccupation première de tout individu, de toute conscience. Pour préserver ce bien, le savoir médical s’est lentement constitué au fil des siècles. C’est peu de dire que les progrès furent lents. Les Egyptiens, les Grecs, les Romains, les Arabes y apportèrent leur contribution, mais jusqu’au XIXe siècle les progrès furent mineurs, tout au moins en matière de résultats pratiques et de performance thérapeutique.
Voltaire pouvait dire en son temps : « Les médecins administrent des médicaments dont ils savent très peu, à des malades dont ils savent moins, pour des maladies dont ils ne savent rien. » La médecine est devenue efficace depuis le siècle dernier, la révolution thérapeutique survient après la deuxième guerre mondiale. La pénicilline et la streptomycine ont à elles seules sauvé des millions de vie et révolutionné la lutte contre les maladies infectieuses, dont la tuberculose. D’autres maladies ont disparu, comme la variole. Les cinquante dernières années sont ainsi marquées par d’innombrables innovations thérapeutiques, dites « de rupture », qui ont bouleversé la façon de prendre en charge les malades et qui ont fait reculer la mort. Mais notre histoire médicale récente est également jalonnée de scandales sanitaires qui ont tour à tour fortement entamé la confiance du public et des malades. Le dernier scandale en date, dont le retentissement médiatique n’est pas encore éteint, est certainement « l’affaire Mediator ».
L’affaire Mediator, c’est l’histoire d’un médicament, le benfluorex, une molécule très proche de l’amphétamine, ayant obtenu son autorisation de mise sur le marché pour le traitement des patients atteints de diabète de type 2, mais dont la toxicité s’est révélée supérieure aux bénéfices thérapeutiques escomptés. Il est reproché à ce médicament d’être à l’origine de graves lésions des valves cardiaques, qui entraînent des fuites aortiques.
Ce médicament a également été détourné de son indication première pour être prescrit comme coupefaim pour des patients en surpoids, qu’ils soient diabétiques ou non. Ils ont été des millions à prendre du Mediator et vraisemblablement plusieurs centaines à développer en conséquence une pathologie valvulaire, dont certains sont décédés. Dans cette affaire, il est reproché au laboratoire qui commercialisait le produit d’avoir dissimulé aux autorités certaines informations scientifiques concernant ce dernier, au point de retarder en France la décision d’arrêter sa commercialisation, survenue en 2009, tandis que les autres fenfluramines, également toxiques, n’étaient plus commercialisées depuis 1997.
Notre administration sanitaire, tous bords confondus, n’a pas été capable de prendre en temps et en heure la bonne décision. Le suivi longitudinal, dans ¨la vraie vie¨, d’un produit proche des amphétamines dont on connait les effets secondaires néfastes, aurait dû permettre de mettre en évidence rapidement à la fois son mésusage et sa toxicité. La surveillance sanitaire n’a pas joué son rôle. Avec le recul, il est aujourd’hui possible de dire que le Médiator a d’abord été une erreur scientifique. Cette erreur a été aggravée ensuite par la mauvaise organisation des services de l’Etat et par les débordements de notre société de consommation.
Tous responsables, le laboratoire, les médecins, les experts, les serviteurs de l’Etat, les ministres successifs et d’une certaine manière les patients. Cette crise sanitaire fut également une crise médiatique, au cours de laquelle l’émotion l’a souvent emporté sur la rationalité, au point de nous empêcher d’affronter la réalité scientifique du dossier. Elle eut de multiples impacts et conséquences, tout d’abord pour les patients victimes des effets néfastes du produit. Elle eut aussi pour conséquence de modifier significativement les conditions d’accès à l’innovation thérapeutique.
Le ministre de la santé en charge au moment des faits proposa une nouvelle loi destinée à restaurer la confiance perdue, notamment la confiance dans l’expertise scientifique et médicale. Ce fut la loi du 29 décembre 2011, dite de « renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé ». Cette loi était notamment annonciatrice d’une nouvelle charte, la «Charte de l’expertise sanitaire», fondée sur les obligations de probité et d’impartialité des experts, dont le principal instrument est la déclaration publique d’intérêt.
A la recherche de l’expert indépendant
Cette loi vise à combattre le climat de défiance qui s’est installé à l’encontre des experts dont l’indépendance est mise en doute. On observe d’ailleurs le plus souvent un glissement sémantique révélateur du climat suspicieux dans lequel nous nous trouvons, puisque de nombreux acteurs parlent, non plus de déclaration des liens d’intérêts, mais de déclaration des conflits d’intérêts. Tous les liens sont donc des conflits et l’impartialité ne suffit plus, c’est l’indépendance qu’il faut démontrer ! [Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle les liens d’intérêts d’un expert sont susceptibles, par leur nature ou leur intensité, de mettre en cause son impartialité ou son indépendance dans l’exercice de sa mission d’expertise au regard du dossier à traiter].
Certains observateurs considèrent même la déclaration publique d’intérêt comme clairement insuffisante et poussent la caricature jusqu’à proposer de lui substituer une déclaration publique d’absence d’intérêts, que devrait signer tout candidat à une nomination dans un comité d’expert. Où trouver donc ces experts dont nous avons besoin pour évaluer les nouvelles technologies innovantes et autres stratégies thérapeutiques ? Au-delà de l’oxymore, l’expert indépendant existe-t-il ? Ou devons-nous simplement nous passer des experts, solution radicale mais pour le moins efficace ! Entre ces solutions extrémistes et parfois caricaturales, il existe sans doute une voie médiane qui réconcilie dépendance et impartialité, qui n’ignore pas les conditions réelles de la construction de l’expertise, au contact notamment des industriels, mais qui protège également la décision publique. Il s’agit d’innover en matière d’élaboration de l’expertise collective et d’organisation de la prise de décision sanitaire.
Ce débat initié sur le médicament est encore plus aigu lorsque l’on s’intéresse au dispositif médical innovant. Le développement et l’évaluation de dispositifs médicaux innovants nécessite de savoir croiser connaissances cliniques et technologiques. On a coutume de dire que l’innovation nait de la rencontre entre le médecin et l’ingénieur, « au lit du patient ». Ces coopérations scientifiques créent de facto une interdépendance, au même titre d’ailleurs que les partenariats public/privé qui sont aujourd’hui prônés pour dynamiser l’innovation en santé. Souhaitée dans un sens et condamnée dans un autre, la dépendance ou la communauté d’intérêt devient lien, et même conflit d’intérêt. La première qualité recherchée chez un expert, tous les acteurs s’accordent à le dire, c’est sa compétence. « Avant tout, il faut qu’il soit bon » (savoir ou savoir-faire, expérience et faculté d’analyse). Dans un contexte d’hyperspécialisation combiné à un phénomène de rendement décroissant de la recherche thérapeutique, les innovations sont le plus souvent incrémentales et les bénéfices ténus, rendant la décision ou le choix des experts de plus en plus délicats. La compétence des évaluateurs est plus que jamais primordiale.
La compétence des experts se construit tout d’abord à l’université, puis au fil d’une carrière professionnelle, notamment au contact des industriels. Souvent même, les liens avec les industriels du médicament et du dispositif médical sont des facteurs de progression de la connaissance et de la compétence des experts.
Ainsi, par construction, un expert devient dépendant. Au départ, il est dépendant de sa formation, de ses maîtres, de son université. Il devient dépendant de son histoire, de ses liens, en particulier avec les industriels. Le lien d’intérêt qui peut naître de cette situation n’est pas que financier, mais ce dernier est le seul facile à mesurer. L’analyse qualitative des liens d’intérêts est d’ailleurs un exercice si délicat que la loi du 29 décembre 2011 a coupé court à toute tentative de mise en application des principes qui prévalaient. Désormais, tous les liens sont « mauvais ». Les experts nommés ne doivent pas avoir de «liens d’intérêt directs ni indirects ». Le paradoxe ainsi créé est que dans un collège d’experts, le seul compétent ne prendra pas part au vote ! Sur ce sujet particulier, la loi du 29 décembre 2011 est jugée difficilement applicable. Doit-on privilégier la compétence ou l’indépendance dans le choix des experts ? Le respect scrupuleux de la loi conduit à nommer dans les commissions plus de pharmacologues et de pharmacovigilants que de cliniciens, au risque de faire prendre de mauvaises décisions. “ Le paradoxe ainsi créé est que dans un collège d’experts, le seul compétent ne prendra pas part au vote ! ”
Où est le bénéfice ? La loi du 29 décembre 2011 semble avoir organisé la pénurie d’experts et la paralysie des commissions d’évaluation. Il est d’ailleurs cocasse de constater que dans sa fameuse charte de l’expertise sanitaire publiée un an et demi après la loi, l’Etat fait en partie marche arrière en acceptant l’idée que l’on peut avoir besoin d’un expert présentant un conflit d’intérêt :
Extrait de « la charte de l’expertise sanitaire » (Décret 2013-413 du 21 mai 2013)
Cas exceptionnels dans lesquels il peut être tenu compte des travaux réalisés par des experts présentant un conflit d’intérêts. A titre exceptionnel, un expert ou plusieurs experts en situation de conflit d’intérêts peuvent apporter leur expertise :
- Si cette expertise présente un intérêt scientifique ou technique indispensable
- Si l’organisme chargé de la réalisation de l’expertise n’a pas pu trouver d’expert de compétence équivalente dans le domaine concerné et qui n’ait pas de conflit d’intérêts.
Dans ces circonstances exceptionnelles et motivées, cet expert ou ces experts peuvent apporter leur expertise selon des modalités arrêtées par l’organisme chargé de la réalisation de l’expertise et portées à la connaissance du commanditaire. D’autres pistes, plus techniques, sont tout de même évoquées pour sortir de ce constat d’une pénurie organisée d’experts compétents et totalement indépendants :
- On diminue la mission ou le champ d’intervention de l’expert. Dans de nombreux cas, tels que pour une AMM européenne, l’expert peut être remplacé par des évaluateurs internes dotés de checklist de sécurité et de qualité. Ce faisant, on s’affranchit certes des liens d’intérêts avec les industriels, mais en redonnant le pouvoir de décision à l’administration, on établit un autre lien d’intérêt, politique cette fois-ci.
- On diminue l’impact de la dépendance de l’expert sur la qualité de la décision. Pour y parvenir, diverses techniques sont possibles et même déjà employées, telles que :
- la fixation d’une doctrine d’évaluation cohérente
- la définition précise du champ d’expertise de chacun
- la collégialité des décisions
- la transparence, plus que l’absence, des liens d’intérêts
- la publicité et la contradiction dans les débats (enregistrement vidéo)
- l’universalité des décisions (lutter contre l’isolement scientifique)
Le respect du principe contradictoire et l’expression des avis divergents sont considérés comme des fondements de l’expertise collective. La recherche du consensus, comme l’expression systématique d’avis divergents, ne sont pas des objectifs en eux-mêmes. Mais la possibilité de garantir l’expression d’avis divergents – que ce soit à travers la composition initiale d’un groupe d’experts, intégrant la diversité des opinions ou des disciplines concernées, à travers une procédure permettant de faire apparaître des divergences éventuelles ou encore lors des séances – constitue un gage de la qualité et de l’indépendance de l’expertise.
Excès de prudence et principe de précaution
Une autre conséquence majeure de cette affaire sanitaire est la frilosité grandissante des Politiques face à l’innovation et le renforcement du principe de précaution. Le sujet n’est certes pas nouveau. Les ardents défenseurs du principe de précaution le présentent comme la clé de voûte d’un monde plus sûr. La décision publique en matière de sécurité sanitaire ou environnementale, tant en France qu’au niveau européen, est soumise au principe de précaution depuis bientôt trente ans.
Sous la pression de l’opinion publique, les décideurs politiques et administratifs prennent aujourd’hui les mesures dites de « précaution » pour éviter demain tout reproche sur l’appréhension qu’ils ont eue d’un risque potentiel. La gestion du risque d’épidémie grippale en France en est une parfaite illustration. Mais l’excès de prudence devient à son tour l’objet de critique, celle d’une société qui n’assume pas le risque d’innovation. Cantonné à un pays, cet excès peut le reléguer au bas du tableau des pays qui innovent.
- Quel juste équilibre trouver entre la précaution face à un risque potentiel et le besoin d’innovation qui porte en lui la promesse d’un progrès ?
- Plutôt que de le bloquer, le progrès technologique peut-il être « intelligemment » encadré ?
- Peut-on mieux appréhender les avantages et les inconvénients des innovations, sans surenchère sur les coûts de développement ?
- Puisque le risque zéro n’existe pas, quel est le degré de risque admissible ou acceptable par notre société ?
Plus que la communication du seul risque vers les usagers ou les patients, ce qui est en jeu pour le médicament comme pour le dispositif médical, c’est la communication autour du rapport bénéfice/risque des technologies concernées. Cette approche équilibrée (« balanced ») d’appréciation des innovations thérapeutiques rend le sujet du principe de précaution particulier et différent du même principe appliqué au domaine environnemental.
Dans le cas du médicament ou du dispositif médical, « je suis prêt à prendre un risque pour gagner un bénéfice ». Pour autant, le principe de précaution doit s’exercer quand le doute scientifique existe, et pas uniquement lorsque l’émotion collective et médiatique s’empare du sujet. Ainsi, sous la pression médiatique, l’homme politique peut prendre une décision que le médecin regrette. L’homme politique est d’autant plus attendu dans ce registre que les français sont habitués à un Etat protecteur. Et pourtant… le principe de précaution est enfreint à chaque fois que l’on octroie une AMM. Bien sûr, le risque zéro n’existe pas, donner accès à un produit de santé c’est prendre un risque, prescrire un produit de santé c’est aussi prendre un risque, accéder aux soins, c’est prendre un risque…
Lorsqu’il est le fruit d’un écart entre perception et évaluation objective du risque, le principe de précaution doit être combattu. Ou plus exactement, cet écart doit être réduit, mais ce n’est pas forcément le rôle du politique que de réduire cet écart. Le politique semble plus dans son rôle lorsqu’il adopte une position « en reflet » de ce que pense la société. Revient-il alors aux experts ou aux médecins de prendre la décision qui convient ? Pour d’autres raisons, ils sont également gênés.
Les experts savent le plus souvent classer et hiérarchiser les risques, mais lorsqu’il s’agit de trancher ou de placer le curseur à un niveau donné, cela devient plus difficile. Le raisonnement de santé publique qui sous-tend la décision collective devient difficilement soutenable lorsqu’il est poussé à son extrême : au nom de quoi peut-on échanger les patients qui supportent les effets négatifs d’une thérapeutique contre ceux qui bénéficient des effets positifs ? Il s’agit là d’un échange difficile à justifier.
Information du patient et pédagogie de la complexité
La décision revient-elle donc aux patients ? Faut-il encore pour cela qu’ils soient éclairés dans leurs choix et à même d’évaluer objectivement les bénéfices attendus et les risques encourus. Au niveau individuel, le rapport bénéfice/risque est une « métaphore abstraite » qu’il est souvent difficile de comprendre. Le patient tout seul ne peut décider. Le professionnel de santé ne peut pas non plus se sentir exonéré de sa responsabilité médicale. Ainsi, les conditions d’une application « raisonnable » du principe de précaution trouvent leur source dans un autre principe, celui de la transparence de l’information scientifique et du dialogue entre professionnels et patients. Le même sujet abordé sous l’angle des plaintes déposées par les patients suite à un séjour hospitalier montre en effet que les patients attendent tout au plus une information sincère et complète sur les choix thérapeutiques qui leur sont prodigués. Si les conditions d’un dialogue et d’une « bonne information » étaient à chaque fois réunies, de nombreuses plaintes ne seraient jamais déposées. “ Plus que l’indépendance de l’expert, il s’agit de la conscience du professionnel qu’il nous faut retrouver. ”
Au cœur du sujet se trouve donc l’information des patients par les professionnels de santé, en accompagnement de la décision médicale. L’information porte sur les bénéfices et bien sûr sur les risques avec une difficulté additionnelle pour les dispositifs médicaux, car le risque qu’ils comportent est le plus souvent associé à une défaillance technologique. Dans notre société moderne imprégnée de fiabilité et de prouesses technologiques, la défaillance technologique est de moins en moins acceptée. Le dialogue prend cependant du temps, celui de la pédagogie de la complexité, complexité du savoir médical, fait de superpositions et de morcellement rendant notamment de plus en plus floue la frontière entre le vrai et le faux.
A cela s’ajoute également un climat suspicieux dans lequel toute nouvelle technologie est accueillie, faisant croire à certains que nous assistons à une inversion du modèle selon lequel « la nature constitue la menace et la science la solution ».
Le progrès technologique présenté est-il un progrès médical ? Est-il un progrès social ? Sommes-nous enfin capables de le financer, selon une logique de budget de substitution ? Ne vient-il pas déranger un ordre établi ou une rente organisée ?
Le produit de santé n’est pas seulement porteur d’un risque sanitaire, mais également d’un risque économique ou financier, ou d’un risque politique et médiatique. Il faut ainsi bien du courage au chercheur entrepreneur pour se lancer dans l’aventure de l’innovation en santé. De ce point de vue-là également la France offre aux chercheurs en quête de valorisation un écosystème peu favorable. Manifestement, la technologie avance plus vite que les mentalités et la synchronisation des cycles de développement de l’une et de l’autre nécessite beaucoup de dialogues et de partage des savoirs, dans une logique horizontale.
Le sujet nous renvoie à l’enjeu de qualité de l’information diffusée vers les médias et vers le public, avec pour seule issue le développement de la compétence et de l’esprit critique de ceux qui reçoivent l’information : le médecin, le journaliste, la personne malade, le consommateur.
Cette quête absolue de l’indépendance vise à restaurer les conditions d’un colloque singulier entre médecin et malade, que certains définissent comme la « rencontre d’une confiance et d’une conscience ». Rabelais en son temps ne disait pas autre chose quand il écrivait « science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Plus que l’indépendance de l’expert, il s’agit de la conscience du professionnel qu’il nous faut retrouver, qu’il soit médecin, expert, industriel ou serviteur de l’Etat.
Henri Parent