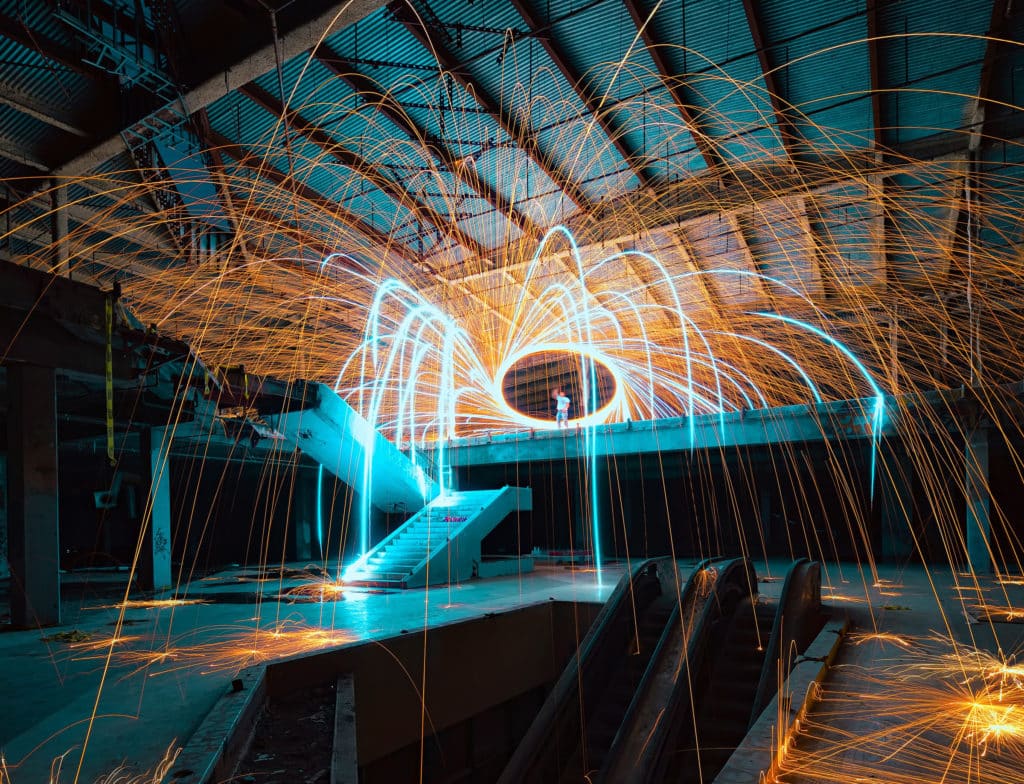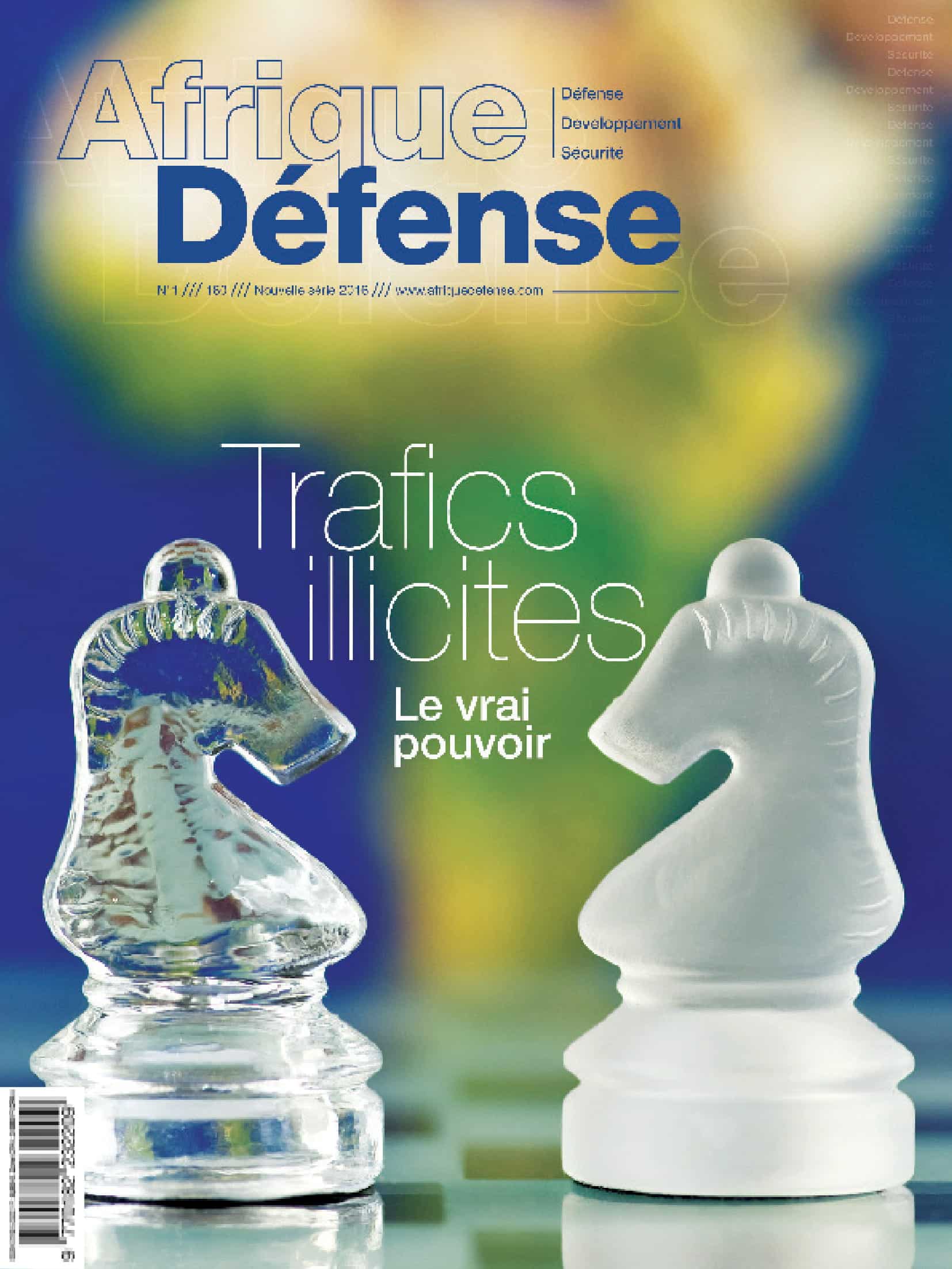Si l’après-guerre a vu émerger dans les sociétés modernes le règne de la technique, les années 1970 ont vu triompher le commercial et le marketing, à leur tour détrônés par la finance au cours des années 1980. Les dirigeants, tout comme les salariés, opèrent dans ce contexte de turbulences, de transformations qui remettent en cause leurs acquis et leurs compétences. En moins d’un siècle, le profil du dirigeant a été bouleversé à plusieurs reprises. Les années 1940, 1950 et 1960 sont l’ère du secteur secondaire ; dans l’entreprise c’est celle de la fabrication industrielle. Celui qui maîtrise les processus techniques maîtrise alors l’usine. C’est donc l’ingénieur qui est en position de diriger l’entreprise. L’invention est l’acte de naissance de l’entreprise. L’inventeur du presse-purée dirige Moulinex, et celui de la cocotte-minute dirige SEB. Le directeur des ressources humaines est alors un technicien de la gestion du personnel. Souvent issu du monde militaire, il est avant tout juriste et garant de l’application des règles et décisions de la direction de son entreprise. Dans la sphère publique, on crée l’ENA en 1945, pour former des techniciens de la chose publique. Dans la sphère sociale, c’est également en 1945 qu’est arrêté le rôle des partenaires sociaux encore en vigueur aujourd’hui. Ils se voient consentir une responsabilité juridique en obtenant de devenir un passage obligatoire pour certains actes de gestion : c’est la naissance du dialogue social à la française.
Le commerce devient prédominant au tournant des années 1960-1970. Entre 1957 et 1962, avec Darty, Auchan, Carrefour, Casino et Leclerc, naissent les chaînes de grands magasins de distribution. L’enjeu n’est plus de fabriquer le meilleur produit, mais de le positionner sur le marché. C’est l’époque de l’essor des écoles supérieures de commerce. Didier Pinault Valencienne, diplômé d’une école de commerce (HEC), prend la tête de Schneider, fleuron de l’industrie, dirigé depuis 100 ans par des ingénieurs. En période de plein emploi, le directeur des ressources humaines devient un psychologue, un recruteur capable de vendre son entreprise aux meilleurs candidats. Dans la sphère publique, en 1965, un candidat aux premières élections présidentielles au suffrage universel, Jean Lecanuet, engage comme directeur de campagne non pas un homme de dossier mais un conseiller en communication, Michel Bongrand, qui façonne le « Kennedy français » : en quelques semaines de campagne, il réunit 15 % de suffrages, ce qui contribue à mettre le Président Charles de Gaulle en ballottage face au candidat unique de la gauche, François Mitterrand. Dans la sphère sociale, la législation organise progressivement en France, à compter de 1955, jusqu’à la rendre obligatoire en 1967 dans les entreprises de plus de 100 salariés, la participation de salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise.
Au début des années 1980, entraînés par la crise économique, nous entrons dans l’ère des services et de la finance. Jacques Calvet, président de la BNP, prend la tête de l’industrie automobile PSA. Le banquier est choisi par la famille Peugeot pour diriger les usines : c’est l’ère de l’argent roi. Le directeur des ressources humaines devient un gestionnaire qui assume lui aussi la dimension économique. Il est progressivement responsable des plans d’intéressement, des plans d’épargne entreprise et de la participation des salariés au capital de leur entreprise, autant de vecteurs de liens à l’entreprise, tous à caractère financier, mais aussi de la conception et de la mise en œuvre de plans sociaux. Dans la sphère politique, on entre dans l’ère de la gestion. Laurent Fabius met en place une politique de rigueur et met fin à l’autre politique de Pierre Mauroy. Dans la sphère sociale, les partenaires sociaux sont de plus en plus associés à la réflexion sur les perspectives économiques et leurs conséquences sur l’emploi. C’est en 1982 que sont créés les comités de groupe en France.1 C’est aussi à ce moment que sont votées les lois Auroux, qui mettaient l’accent sur la responsabilisation des partenaires sociaux.
À la poussée du secteur des services tout au long du XXe siècle s’ajoute, au cours des années 1990, l’émergence du secteur des services à la personne. Dans ces nouvelles entreprises, la production de services ne suppose pas d’usines de fabrication : le façonnage et la livraison des produits virtuels ne nécessitent plus désormais que des hommes. De plus, les savoir-faire et les métiers qui ne sont pas au cœur de la mission que se donne l’organisation sont en voie d’externalisation et d’automatisation, telles les fonctions supports internes (comme les systèmes d’information, les ressources humaines, les affaires juridiques, les achats ou la communication). L’enjeu consiste dorénavant pour le dirigeant à écouter et réfléchir avec ses réseaux de parties prenantes (salariés, partenaires, actionnaires et clients). Il est une intersection qui fait la jonction entre toutes les contraintes, attentes et propositions. Il se doit désormais de savoir agréger l’ensemble des données afin d’optimiser la compréhension par tous des évolutions des marchés et des adaptations nécessaires des produits et des modes organisationnels qui en découlent.
Le dialogue devient indispensable
Les difficultés et impasses dues aux crises économiques, financières ou sociales sont le plus souvent des crises de l’écoute. Mais, pour que la logique des intérêts particuliers ne supplante pas celle de l’intérêt général, encore faut-il affermir la considération réciproque et le respect mutuel. Or, marier des contraintes divergentes au premier abord suppose d’agréger et de conjuguer les flux croissants de données générées par les nouveaux moyens techniques de communication. Cet accès facilité à l’information engendre des niveaux de complexité accrue, qui viennent percuter la mission des corps intermédiaires (élus, managers, organismes socioprofessionnels). Il s’en suit la déstabilisation de leur autorité et de leur légitimité quand ils n’ont pas fourni la preuve qu’ils sont mieux armés que leurs mandants pour construire des analyses transversales. Aussi, les acteurs qui ne se sentent plus correctement représentés peuvent se replier sur eux-mêmes, ne plus s’intéresser qu’à leurs enjeux personnels ou à des sujets ludiques et ne plus se comporter qu’en consommateur. Or, face au consumérisme, la réponse la plus simple est le clientélisme : pour préserver la relation, il suffit alors, en effet, de donner raison à toute personne qui prend la parole, quoi qu’elle dise. Mais ne nous y trompons pas, cette spirale de l’individualisme est bien une aventure pleine de menaces pour l’entreprise comme pour la société. En effet, un niveau d’engagement plus faible pour autrui, comme pour tout ce qui nous entoure, induit une baisse d’attention et de vigilance, interdit d’entrer dans la complexité et produit in fine, une perte de capacité de changement et d’innovation.
Pour s’extraire de cet enfer de l’immobilisme, de l’immédiat et du court terme, le décideur doit sortir du champ technique et financier, pour intégrer la dimension humaine dans sa globalité et traiter les imperfections de chacun, voire même ses incohérences. C’est pourquoi, il devient nécessaire de s’accorder le temps de l’écoute, génératrice d’approfondissement, d’empathie et d’appropriation, et de la réflexion collective. En reprenant possession de leur temps, les dirigeants, tout comme les dirigés, reconquièrent la maîtrise du développement de leur organisation en précisant le sens de leurs projets à travers la réflexion collective, éclosive de nouveaux regards et de nouvelles idées. Bien sûr, expliquer est une réponse à l’obligation de pédagogie, d’information transparente, de partage de savoirs. Mais, si l’explication est éclairante pour l’auditeur attentif, elle comporte cependant plusieurs limites : certains peuvent être en désaccord, d’autres ne pas comprendre, d’autres enfin ne pas écouter parce qu’en rejet a priori de l’émetteur, ou tout simplement absents. De plus, si seul l’expert devrait s’autoriser à transmettre de l’expertise, de nombreux amateurs n’hésitent pas également à s’y essayer sans avoir toujours pris les précautions de vérification de leurs savoirs. Mais qui, dans notre monde inondé d’informations, est certain d’avoir vraiment tout compris au point de n’avoir plus qu’à expliquer ? Et qui, même parmi ceux qui auraient tout compris, se trouve vraiment en situation de légitimité auprès de ses publics au point de pouvoir se faire vraiment écouter, entendre et comprendre ?
Écouter est indispensable lorsque l’on ne détient pas tout le savoir nécessaire pour vraiment bien comprendre. Lorsque le dirigeant sait qu’il ne sait pas tout, l’écoute lui permet de saisir les attentes, les situations, les savoirs, les expériences. Après avoir entendu, il est censé avoir mieux compris, mais il court alors deux risques lorsqu’il prend la parole. D’une part, s’il a bien entendu toutes les parties prenantes, il est le seul à l’avoir fait, et il reste le seul en situation d’avoir tout compris. Au moment où il fait part de son analyse et de ses préconisations, tous ceux qui comprennent qu’ils n’ont pas été suivis, peuvent se sentir trahis ou plus simplement en droit, selon le principe de la réciprocité primaire, de ne pas le suivre. D’autre part, n’ayant pas forcément été au bout du raisonnement de certains, pour ne pas les avoir mis tous en situation de disputation démocratique transparente, il prend le risque d’avoir à donner raison aux intérêts particuliers dont le raisonnement est le mieux articulé. Pourtant, n’avoir pas procédé à la confrontation constructive de tous les raisonnements constitue bien un dommage pour la quête de la vérité, la maitrise de l’argumentation n’étant pas une garantie d’avoir raison sur le fond. À une époque où la diversité de l’information forge autant d’opinions que de personnes, chacun veut de plus en plus s’exprimer pour participer à l’élaboration des décisions et refuse d’adhérer a priori. Le rôle nouveau du dirigeant devient ainsi d’animer l’écoute mutuelle en s’assurant de l’inclusion de toutes les parties prenantes dans un échange constructif. L’évidence se fait que l’explication, et l’écoute même, ne suffisent pas à garantir un dialogue de qualité et à faire émerger des innovations porteuses d’intérêt général :il faut réfléchir avec tous, en animant des liens interactifs permanents.
De la qualité du dialogue dépend le degré de cohésion et le niveau de performance future d’un corps social. À partir du moment où les acteurs appréhendent et comprennent les enjeux inhérents à leur structure, qu’ils perçoivent bien que leurs propos sont pris en compte à égalité avec ceux des autres, qu’ils sont considérés à leur juste valeur, ces acteurs ne vont-ils pas mieux s’impliquer dans la vie de leur organisation, et donc générer plus d’efficacité ? Ainsi, une bonne gestion conduit les organisations, qu’elles soient à caractère économique, politique ou social, à valoriser la participation de leurs interlocuteurs en les écoutant attentivement et à les faire s’écouter les uns les autres. La relation dirigeant-dirigés doit à présent reposer sur le dialogue, l’écoute, la reconnaissance et le respect mutuel, nouvelles bases de la confiance.
Seule une réflexion collective, construite de façon rigoureuse, génère des projets solides recueillant l’adhésion du plus grand nombre. Or, le dialogue est à la fois simple et complexe : la différence est ténue entre une discussion d’où jaillit la lumière et un dialogue de sourds, générateur de frustrations et amplificateur de divergences. La science du dialogue, la dialectique, répond à des méthodes et des principes bien définis.
Transcender les intérêts particuliers et forger une vision commune des contraintes et projets supposent de définir et mettre en œuvre une méthode de réflexion collective qui saura organiser la confrontation objective et constructive des différents avis et propositions. Maîtrisée et appliquée, la dialectique accroît directement la performance. La méfiance généralisée entre dirigeants et dirigés provient du manque de maîtrise de la dialectique. Ainsi mode de gouvernement, mode managérial et mode relationnel sont remis en cause. Les dirigeants doivent s’adapter et apprendre à puiser dans ce gisement encore inexploité qu’est le dialogue avant d’engager des décisions.2
Deux siècles après l’apparition de l’imprimerie, dans son Discours de la méthode,3 René Descartes posait les principes de l’organisation de la réflexion individuelle. Nous devons à présent écrire le tome II de ce traité, qui y ajoute les principes de la réflexion collective.
Maîtriser l’intelligence sociale
L’intelligence sociale est la connaissance du lien social au service de la recherche de l’intérêt général.
La croissance globale et la performance d’une organisation ne dépendent donc plus seulement des compétences techniques réunies, mais de plus en plus de la capacité des gérants et des élus à faire réfléchir et à réfléchir avec leurs interlocuteurs. Dans la société et dans l’entreprise, le nouvel enjeu économique, politique et social devient donc la maîtrise de l’organisation du dialogue et de la réflexion collective pour chercher ensemble l’intérêt général : c’est l’intelligence sociale qui définit et renforce la capacité d’une personne ou d’un groupe de personnes à développer simultanément du lien social et de la performance durable.
L’intelligence sociale est la connaissance du lien social au service de la recherche de l’intérêt général. L’intelligence sociale consiste à développer une culture de responsabilité économique et sociale dans la perspective de développer simultanément et à long terme les performances économiques et les performances sociales, sur le double plan individuel et collectif.
L’intelligence sociale organise l’étude et la maîtrise des phénomènes relationnels :
- Elle recense et décompose les forces et les faiblesses des personnes, des organisations et des liens qu’elles entretiennent, leur histoire, leur nature et leur qualité afin de donner un schéma et des clés de compréhension de leur fonctionnement.
- Elle structure l’effort de découverte, de compréhension et d’appropriation des racines et des mécanismes de développement de la cohésion sociale et de la performance globale. Sa maîtrise permet d’adopter comme mode opératoire le dialogue continu et la réflexion collective.
- Elle définit et propose les opérations correctives des modes relationnels, organisationnels et de gouvernance qui permettent de tisser des liens durables, cohérents et convergents entre toutes les parties prenantes et interlocuteurs présents et futurs.
L’intelligence sociale s’appuie sur la reconnaissance de l’existence des mécanismes psychologiques, sociologiques, ethnologiques et philosophiques qui influencent à bas bruit, favorablement ou défavorablement, toutes les relations interindividuelles, intra- et intersystémiques. L’intelligence sociale prend en compte des caractéristiques individuelles ou propres à un groupe, permet d’identifier la cause de comportements différenciés et de paramétrer les processus spécifiques de transformation.
L’intelligence sociale constitue un approfondissement de la connaissance des sciences de l’homme. Cette discipline des sciences humaines permet de repérer, analyser et renforcer les savoir être ensemble des personnes physiques et morales, et donc, à terme, les performances individuelles et collectives.
Pour développer l’intelligence sociale de leur organisation, les décideurs doivent construire simultanément le « vouloir dialoguer » (attitude), le « pouvoir dialoguer » (situation) et le « savoir dialoguer» (capacité).4 Chaque contributeur est alors à même de mieux capter tous signaux relatifs au climat social, ainsi que les propositions d’optimisation du fonctionnement et des services rendus. Ainsi, cette « veille sociale » continue devient le moyen de générer une culture non de guérison, mais de prévention par le dialogue.
Comprendre et transformer le contexte
Mais, animer un collectif en permanence sur la durée suppose de comprendre ce qui relie ses composantes les unes aux autres. Un préalable est donc de procéder à une analyse des jeux d’acteurs, de leurs rapports de force et de leurs intérêts particuliers pour les faire converger vers des intérêts collectifs à long terme. Il s’agit de réconcilier l’organisation (société, entreprise, syndicat…) avec toutes ses parties prenantes, aux yeux de certaines desquelles elle peut apparaître comme étrangère, du fait d’une dissonance dans la représentation collective de sa mission et de ses valeurs. Pour ce faire, la révolution des structures peut s’avérer nécessaire, mais elle ne suffit pas : elle doit être accompagnée d’une révolution des esprits. En effet, transcender les intérêts particuliers n’est possible qu’en s’extrayant de l’actualité immédiate, en dépassant son passé personnel pour se projeter dans un futur commun. La question devient alors : « À quoi servirons-nous ensemble, demain, à autrui ? ». Ceci suppose de se tourner vers l’extérieur, vers ceux à qui l’on rend service, ceux qui bénéficient de notre travail, ceux qui justifient notre existence. Ceux-là sont des clients, des citoyens, des personnes : il s’agit donc de formuler une vision de la société et du rôle que l’on veut y jouer, puis de leur proposer des modalités d’implication correspondant à leurs possibilités réelles et perçues. Pour que chacun adhère et participe à un nouveau contrat relationnel, il faut que tous en partage la même définition. Or, chercher sa raison d’être et affirmer une mission revient souvent à réaliser sinon une révolution identitaire, ou tout au moins une évolution de son identité.
L’abbé Sieyès est le père fondateur de la Révolution française, car c’est lui qui a trouvé et activé la clé des changements. Le 17 juin 1789, partant du constat du décalage entre le poids démographique du tiers état (98 %) et son poids politique (un tiers des voix seulement, un tiers relevant de la noblesse et un autre tiers du clergé), exposé dans son essai Qu’est-ce que le Tiers-État ?, il amène le tiers état à se proclamer Assemblée nationale. Instantanément, les acteurs de cette révolution identitaire portent un regard transformé sur leur environnement et leurs marges de manœuvre. La responsabilité nouvelle qui en découle et leur incombe les conduit à enchaîner en quelques semaines des décisions innovantes et restructurantes. Sans ce changement profond de prisme, pas de prise de la Bastille le 14 juillet, pas de nuit de l’abolition des privilèges le 4 août, ni de Déclaration des droits de l’Homme les 24 et 25 août. Attention toutefois, l’exemple de la Terreur de 1793 nous rappelle le risque inhérent au changement lorsque l’élargissement de la réflexion n’est pas maîtrisé.
Ainsi, dans cette « logique du 17 juin », il suffit souvent de ne prendre qu’une seule décision consistant à préciser et redéfinir ce que nous sommes pour déclencher des décisions en cascade à tous les niveaux. Il s’agit de produire une (r)évolution à caractère identitaire, qui affirme à la fois un éthos, fondement profond du caractère à travers lequel il est possible de lire l’ensemble de son passé, et un télos, raison d’être et finalité qui orientent tous les actes à venir.
L’affirmation d’une identité nouvelle, plus précise, mieux adaptée, lisible, comprise, partagée et appropriée, constitue la rampe de lancement d’une spirale de la responsabilité collective : elle est le déclencheur de décisions, convergentes et en cascade, à tous les niveaux et par toutes les composantes du corps social.
Comprendre et transformer tous les acteurs
En éclairant les logiques d’actions individuelle et collective, il s’agit de permettre à tous d’affirmer clairement un sens partagé et déployé :
- « Moi, citoyen, à quoi je sers tant sur le plan professionnel et sociétal, outre mes enjeux individuels ? »
- « Moi, organisation (entreprise, syndicat, administration, ONG…), quel est mon objet social, à quoi j’œuvre et contribue, outre mes enjeux collectifs et le souci de ma rentabilité financière ? »
- « Moi, société, comment j’intègre et j’associe tous les acteurs dans la quête de l’intérêt général à long terme ? ».
Traiter du sens comme d’une question politique, au sens noble du terme, c’est savoir débattre d’un projet global qui fournira un cadre à la fois protecteur et générateur d’initiatives, tout en restant le garant de la coopération sociale. C’est donc, du même coup, s’efforcer de dégager les conditions auxquelles les personnes, les entreprises et la société pourront conjuguer leur part de responsabilité, voie du développement économique, du réussir ensemble, avec plus de solidarité et de cohésion sociale pour mieux vivre ensemble.
L’objectif du dialogue est d’aider les personnes à mieux vivre ensemble et mieux réussir ensemble, plutôt qu’à les laisser se débrouiller toutes seules. Or, identifier tous les paramètres, pour ensuite les combiner de façon à ce qu’ils favorisent le meilleur épanouissement possible de tous et de tout, est d’une telle complexité que cela revient à adopter une posture de remise en question et de doute constructif permanent. À l’inverse, celui qui pense pouvoir réussir mieux tout seul n’éprouve pas le besoin de dialoguer avec quiconque. La contrepartie indispensable de ce doute est la certitude d’un sens sociétal affirmé et d’une raison d’être comprise et partagée par tous, parce que perçue comme mieux appropriée à l’évolution de la situation à long terme. Pour oser optimiser en continu des modes opératoires toujours perfectibles, il faut être certain de ses valeurs, du sens que l’on partage avec les autres et de la méthode de recherche de l’intérêt général.
L’ensemble des expériences de dialogue à grande échelle, travaux d’étude et de recherche appliquée sur l’intelligence sociale conduits par l’ODIS depuis 1990 lui a permis de formaliser une expertise et de la théoriser à travers huit familles de modèles de l’intelligence sociale.5
Les concepts de l’intelligence sociale sont des règles universelles qui président à l’organisation des relations à soi-même et aux autres. Elles s’imposent à tous et sont à l’œuvre en toutes circonstances. Ne pas les appliquer revient à courir à l’échec à long terme. Ne pas les connaître revient à risquer le rejet, voire la sanction, sans comprendre les raisons de la déconvenue. Les appliquer sans les connaître revient à réussir sans trop savoir ce que sont les racines du succès, c’est ce que l’on appelle la chance. Inversement, elles fondent la réussite de ceux qui les connaissent et les appliquent. Ainsi, si Alexandre de Macédoine devint Roi des Grecs (en Europe), Roi (Pharaon) des Égyptiens (en Afrique) et Empereur des Perses (en Asie), c’est parce qu’il était dans la filiation immédiate du maître de la maïeutique : son précepteur Aristote avait été l’élève de Platon, lequel était l’élève de Socrate. Le succès sans équivalent dans l’histoire du monde de ce grand conquérant et unificateur de cultures et de continents est donc à mettre au crédit de sa capacité à appliquer la dialectique, apprise au contact direct et privilégié de ses concepteurs et conceptualisateurs encore reconnus comme les grands maîtres de la philosophie vingt-cinq siècles après leur mort.
Le rôle du dirigeant : faire réfléchir ensemble
Comment produire un sens partagé quand chacun réfléchit dans son coin ? Il est évident que cela ne pourrait relever que du hasard, car des raisonnements différents ne peuvent que produire des conclusions différentes. En conséquence, ceux qui ne sont pas associés à la réflexion risquent fort, en miroir, de se dissocier de la conclusion de la réflexion.
Pour se sentir utile, il faut être impliqué. Le premier niveau de l’implication réside dans la prise de parole : être impliqué suppose donc d’être écouté. Or, il faut savoir donner la parole sans pour autant donner raison. Seul un raisonnement partagé est générateur de constats et de propositions communes. Ainsi, si le dirigeant se trouve dans une posture d’écoute, sachant se remettre en cause et s’adapter en permanence à ses interlocuteurs, par effet miroir et mimétique, ceux-ci entrent, eux aussi, dans une logique de respect et d’écoute mutuels. La confiance s’instaure alors entre dirigeants et dirigés, ce qui permet non pas de faire abstraction des contraintes, mais de les comprendre comme n’étant pas imposées par le chef, mais plutôt par la situation dans son ensemble. Ainsi, par la réflexion collective, les acteurs, en entrant dans des logiques constructives de changement pour inventer ensemble un monde meilleur, déconstruisent eux-mêmes leurs routines défensives. C’est ainsi que le dialogue organisé favorise la responsabilisation et l’autonomie de chacun.
Cette mutation des modes de pilotage des interactions à long terme s’impose à présent comme une nouvelle forme de compétences. De fait, dans un monde en pleine mutation, il devient indispensable de mesurer et de développer la capacité de chaque personne et de chaque organisation, à réfléchir avec les autres pour mieux s’épanouir ensemble. À travers le développement de l’intelligence sociale des personnes, des organisations et de la société, il s’agit d’embrasser simultanément les deux sphères de la performance économique et de la cohésion sociale. C’est cette aptitude à déployer et dynamiser la dimension humaine qui permet de consolider l’adhésion solide et durable de tous, la préparation du changement, la prévention des crises, l’utilisation à plein de la richesse humaine, la recherche et la diffusion des idées nouvelles, l’épanouissement de chacun, la conjugaison des intérêts particuliers et de l’intérêt collectif et général.
Bien sûr, pour avoir prise sur la réalité et être efficace, un dialogue aussi ambitieux répond à un cahier des charges précis. C’est là qu’interviennent les principes du dialogue qui définissent comment organiser des échanges générateurs d’innovations appropriées par tout le corps social, et donc comment développer la cohésion de ce corps social et, in fine, sa performance.
Jean-François Chantaraud
Notes
1 Organes de consultation de l’ensemble des salariés des différentes entreprises appartenant à un même groupe.
2 Le dialogue est un échange organisé qui se définit à travers cinq dimensions interconnectées :
- Les interlocuteurs : avec qui parle-t-on ? Un vrai dialogue est ouvert à toutes les parties prenantes concernées directement ou indirectement par l’une des options envisagées par l’ensemble des acteurs. Pour qu’un dialogue efficace s’instaure, chacun doit pouvoir s’exprimer équitablement et écouter avec bienveillance, et sans complaisance, toutes les sources d’information, d’analyse et de proposition.
- Le thème : de quoi parle-t-on ? Pour le Maréchal Foch, la question clé était toujours : « De quoi s’agit-il ? ». Bien poser le problème est une phase préalable à sa résolution. Le dialogue se tient donc toujours sur un thème spécifique.
- Le moment : quand parle-t-on ? Le dialogue se tient en amont de la décision. Une fois qu’une décision est prise, le décideur communique pour informer. Si la décision a déjà été prise ou est sur le point d’être prise au moment où s’organise le dialogue, celui-ci devient alors de la manipulation. Mieux vaudrait alors s’en tenir à des explications en communiquant sans prétendre au dialogue.
- Le lieu : où parle-t-on ? Un dialogue ouvert se tient sur un territoire dont la localisation, les moyens logistiques et l’image qu’il véhicule sont à équidistance de toutes les parties prenantes invitées à participer et à se réunir. Le lieu doit être neutre dans l’imaginaire des participants.
- La méthode : comment parle-t-on ? Le processus se décompose en cinq grandes phases : les dirigeants sollicitent les avis et propositions de tous, les informations collectées sont classées, elles sont analysées par des personnes qui forment un groupe légitime aux yeux de tous, les éléments du débat et de l’analyse sont diffusés à tous, et enfin, les décideurs décident.
3 René Descartes, Discours de la méthode, publié à La Haye le 8 juin 1637 :
- Ne recevoir aucune chose pour vraie tant que son esprit ne l’aura clairement et distinctement assimilée préalablement : faire confiance et vérifier.
- Diviser chacune des difficultés afin de mieux les examiner et les résoudre : dissocier les faits des opinions.
- Établir un ordre de pensées, en commençant par les objets les plus simples jusqu’aux plus complexes et divers, et ainsi de les retenir toutes et en ordre : construire une échelle de la complexité.
- Passer toutes les choses en revue afin de ne rien omettre : être exhaustif.
4 Les cinq principales dimensions de l’intelligence sociale :
- L’attitude – le vouloir dialoguer : le système de valeurs. Quelles sont les aspirations ? Quelle est la conception des rapports avec autrui ? Mesure de l’ouverture d’esprit, de l’objectivité, de l’ouverture à la contradiction, de la capacité à se remettre en cause, de la responsabilité intellectuelle, de l’humanisme et de la sensibilité à l’intérêt général.
- La situation – le pouvoir dialoguer : les contextes dans lesquels les personnes évoluent. Quel est le degré perçu de l’ouverture de l’environnement ? Quelles sont les marges de manœuvre possibles pour être écouté, pour s’exprimer, pour être entendu, pour innover ? Mesure de l’ouverture du contexte structurel et humain, de ses différentes croyances, des possibilités d’innover et de recherche individuelle et collective de l’intérêt général.
- La motivation – les raisons réelles du dialogue : les moteurs de l’action. Quelles sont les attentes concrètes des personnes ? Quelle vocation se donnent-t-elles ? Quelle est la nature de leurs ambitions ? Mesure des moteurs et des fondements de l’action et des interactions avec les interlocuteurs.
- L’implication – la nature de l’engagement : la nature concrète des objectifs poursuivis. Quels sont les projets et interactions en cours ? Quelle est leur orientation en pratique ? À quoi la personne travaille-t-elle ? Mesure des desseins et de la finalité réelle des actions engagées.
- Le comportement – le savoir dialoguer : les modes de gestion des relations et interactions. Quelles sont les pratiques relationnelles et d’animation ? Mesure de la maîtrise des outils et techniques de dialogue, de la capacité à écouter, à organiser la réflexion collective, à modifier les comportements, à chercher l’intérêt général en groupe, à animer cette recherche.
Les cinq dimensions s’influencent mutuellement. La définition précise de ces cinq dimensions et de toutes leurs composantes à travers l’échelle de la complexité (ODIS, L’état social de la France et de ses régions, La Documentation française, 2013, p. 121) permet de bâtir un questionnaire de type Quotient d’intelligence sociale (Ibid., p. 119), qui positionne les répondants selon une métrologie de 0 à 100. L’analyse des différentiels permet de bâtir des plans de développement individuels spécifiques.
5 Les huit familles de modèles de l’intelligence sociale (ODIS, L’état social de la France, La Documentation française, 2013, p. 124) :
- Grille d’analyse du lien social. Mise en perspective des différents modes de fonctionnements passés, actuels et possibles des organisations et des acteurs. La grille d’analyse du lien social éclaire la compréhension des jeux d’acteurs et leurs raisons. En repérant la nature du lien social et en appréciant sa qualité, elle permet d’estimer sa durabilité et de réaliser des projections des performances futures d’un organisme ou d’une personne.
- Les 9 principes fondamentaux du dialogue. Principes d’animation des relations interpersonnelles et des collectifs, dans l’instant et sur la durée.
- Cohérence globale de l’organisation. La cohérence globale permet à un corps social d’assumer son identité, au quotidien, en fortifiant les corrélations entre le sens cherché et les actes posés.
- Les spirales sociales. Mécanismes de l’implication progressive des parties prenantes à travers leur appropriation de l’esprit des règles.
- Management de l’organisation par l’identité (M.O.I). Déclinaison méthodique des valeurs d’une organisation dans l’ensemble de ses composantes, ses structures, sa politique de ressources humaines de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, de formation, de communication interne et externe, de développement durable. En induisant un mode managérial lisible par tous, un Plan M.O.I. optimise tous les vecteurs de lien avec les collaborateurs.
- Partage des valeurs. Méthode stratégique d’implication de chaque partie prenante (collaborateurs, actionnaires, fournisseurs, partenaires, clients, citoyens) dans des projets communs. Le partage des valeurs permet d’optimiser tous les vecteurs de liens avec les acteurs extérieurs à l’organisation.
- Grille d’analyse de l’identité collective. La Grille d’analyse de l’identité collective permet de décomposer le sentiment identitaire d’un collectif en quatre grandes dimensions : ses liens au territoire (où se trouve-t-il ?), ses codes relationnels (comment se comprend-il ?), son parcours historique (d’où vient- il ?), son projet collectif (où va-t-il ?).
- Grille d’analyse de l’apogée des sociétés. Décomposition par phase des corrélations entre la performance, le lien social, la gouvernance et le profil des dirigeants.